
Disomie uniparentale et pathologie
On appel disomie uniparentale les situations au cours desquelles les deux chromosomes d'une même paire chromosomique (par exemple les deux chromosomes N°1) sont transmis par le même parent, soit le père, soit la mère.
Selon les règles de la génétique mendelienne, il ne devrait en résulter aucune conséquence puisque la fraction du génome concernée est bien présente en deux exemplaires. Or, si effectivement pour la majorité des paires chromosomiques il n'y a aucune conséquence phénotypique, pour certains chromosomes (en rose soutenu et en bleu foncé sur la carte) cette situation conduit à des pathologies que l'on commence à identifier. C'est ainsi le cas pour la disomie uniparentale maternelle du chromosome 7 qui est associée au syndrome de Silver Russel, la disomie uniparentale paternelle du bras court du chromosome 11 qui est associée au syndrome de Beckwith Wiedemann, la disomie uniparentale paternelle ou maternelle du chromosome 14 associée à deux syndromes différents. On retrouve également le chromosome 15, associé à un syndrome de Prader Willi en cas de disomie uniparentale maternelle et à un syndrome d'Angelman en cas de disomie uniparentale paternelle.
Pour d'autres paires (chromosomes 2, 6, X …), l'existence d'un phénotype propre à la disomie uniparentale ne peut pas encore être affirmé avec certitude mais elle est fortement suspectée.
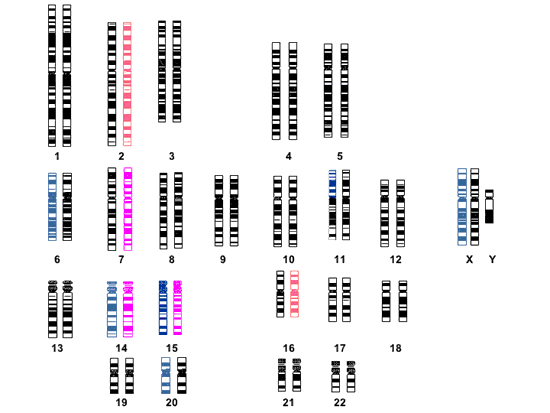 cliquer sur l'image pour voir une version agrandie
cliquer sur l'image pour voir une version agrandie
L'existence de manifestations cliniques associées aux cas de disomie uniparentale traduit donc une différence d'expression de certains gènes (pas tous) localisés sur ces chromosomes. La carte des chromosomes associés à des signes cliniques en cas de disomie uniparentale donne ainsi un aperçu des régions potentiellement soumises à empreinte chez l'homme.
![]()